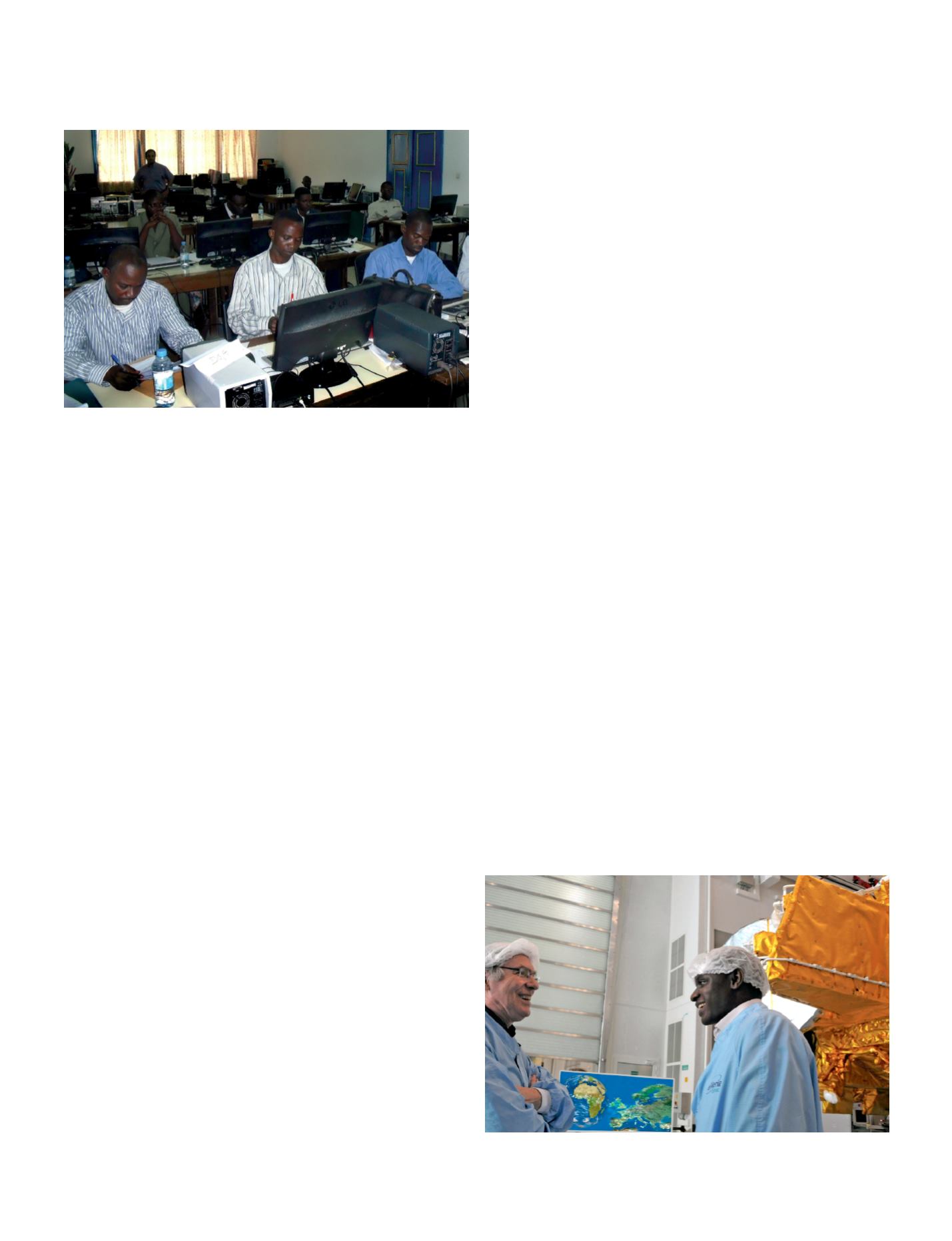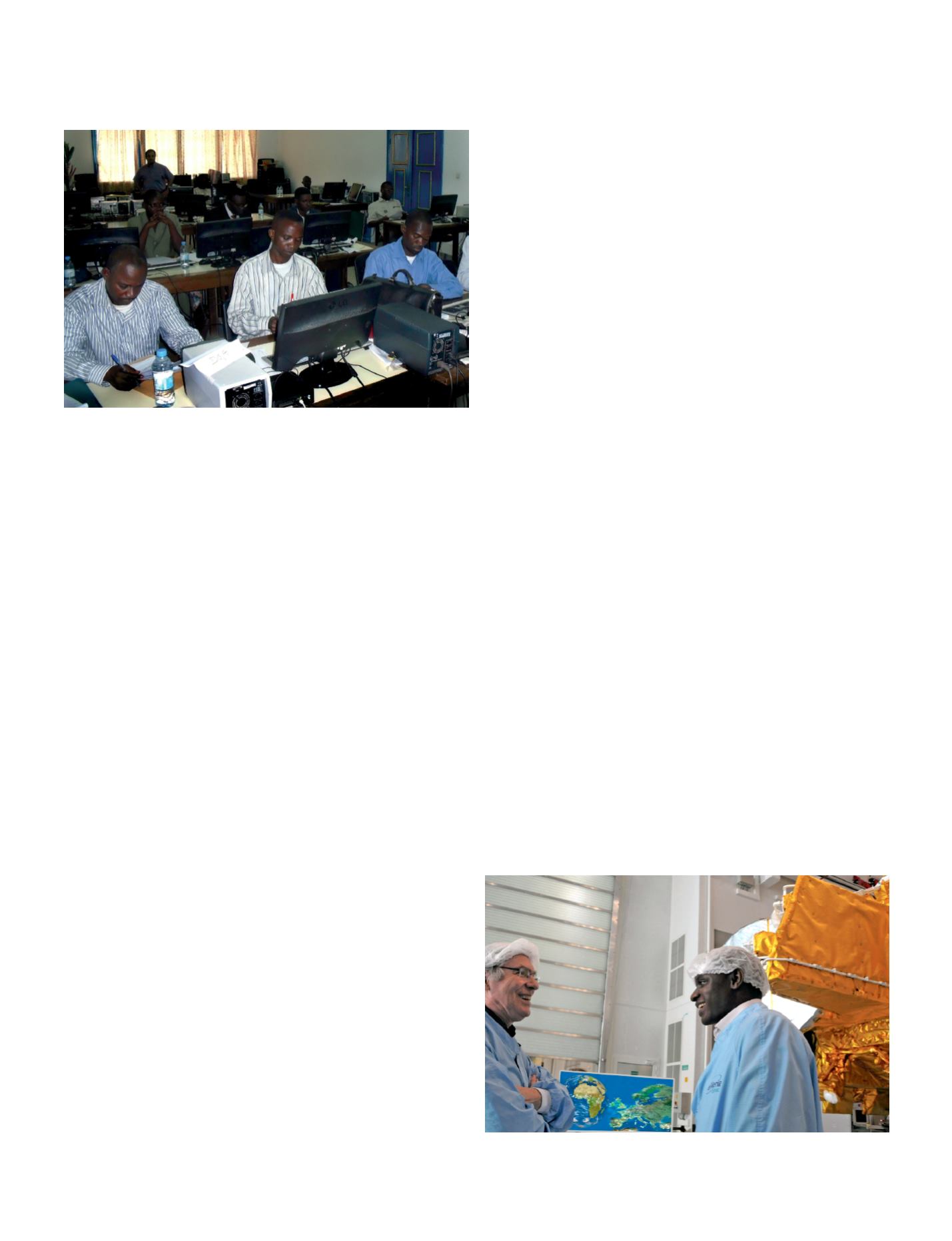
D
ans l’indicateur du développement technologique du PNUD,
qui mesure la capacité à créer des technologies, à les diffuser
ainsi que les compétences humaines qui vont de pair avec leur
exploitation, l’Afrique est à la traîne. Sur cinq catégories de pays, au-
cun pays africain ne se hisse aux deux premières places. Quatre pays
figurent dans la catégorie intermédiaire, cinq se classent dans l’avant-
dernière catégorie en étant décrits comme "marginalisés sur le plan
technologique". Tous les autres pays appartiennent à la dernière ca-
tégorie et sont qualifiés de “sous-marginalisés”. Cela indique que
l’Afrique doit être plus compétitive non seulement en comptant sur les
coûts de samain-d’œuvremais également en améliorant l’innovation,
la recherche et le développement.
Pour assurer la transition vers le développement durable, le
continent africain doit s’appuyer essentiellement sur le couple science
et technologie. En 2005, le NEPAD et la Commission de l’Union afri-
caine, en coopération avec l’UNESCO, ont élaboré le Plan d’action
consolidé pour le développement de la science et de la technologie en
Afrique. Il s’articule autour d’actions collectives, destinées à dévelop-
per et à utiliser la science et la technologie en vue d’une transforma-
tion économique et sociale et de l’intégration de l’Afrique dans l’éco-
nomie globale. Ce plan est basé sur trois piliers interconnectés : le
renforcement des capacités, la production de connaissances et l’inno-
vation technologique. L’accent est mis sur le développement d’un sys-
tème africain de recherche et d’innovation technologique – à travers
les réseaux régionaux de centres d’excellence pour des programmes
de R&D – et de renforcement des capacités. Pour y parvenir, là où
l’innovation est absolument nécessaire, il est essentiel d’améliorer
les capacités de recherche et de mettre en place des réseaux pour un
partage des connaissances et des bonnes pratiques.
Les pays africains ont participé activement au Sommet mondial
sur la société de l’information (SMSI), dont le but était de résoudre
le problème de la fracture numérique. Ils ont adhéré aux orienta-
tions de la politique du SMSI qui prévoit d’édifier une société de
l’information inclusive, de mettre tout le potentiel de connais-
sances des technologies de l’information et de la communication
(TIC) au service du développement, de promouvoir l’utilisation de
l’information et de la connaissance pour la réalisation d’objectifs
de développement inscrits dans des accords internationaux, y
compris ceux prévus dans la Déclaration du Millénaire. Et enfin de
Les technologies au service du développement
L’Afrique et l’Europe travaillent la main dans la main pour développer les technologies
spatiales dans le secteur des télécommunications, de l’accès à Internet, de l’observa-
tion de la Terre et du suivi de l’environment.
Thales Alenia Space. © Serge Henri
relever les nouveaux défis posés par la société de l’information, au
niveau régional, national et international.
Pour traduire ces objectifs en programmes réalisables, les
pays africains devront adopter plusieurs mesures prioritaires :
promouvoir les TIC à des fins de développement, mettre en place
des infrastructures d’information et de communication, favoriser
l’accès à l’information et à la connaissance, renforcer les capaci-
tés, promouvoir les contenus reflétant les diversités culturelles
identitaires et linguistiques, les contenus locaux ainsi que, parmi
d’autres, les dimensions éthiques de la société de l’information.
Pour que la technologie puisse jouer un rôle clé dans le déve-
loppement durable du continent africain, le renforcement des poli-
tiques en matière de science et technologie et le développement
d’organismes compétents sont des préalables absolument néces-
saires. Dans de nombreux pays africains, et notamment les plus
petits d’entre eux, les institutions en charge du développement
restent modestes. Le renforcement des capacités, et particulière-
ment les moyens en ressources humaines ainsi que le développe-
ment des connaissances de base sont autant de conditions essen-
tielles au développement durable du continent.
Pour ce qui concerne la science et la technologie spatiales, une
poignée de pays africains a ratifié le Traité sur l’espace de 1967,
l’Accord relatif aux opérations de secours de 1968 et la Convention
de 1972 sur la responsabilité internationale sur les dommages
causés par des objets spatiaux. Seuls, le Nigeria et l’Afrique du Sud
se sont dotés d’une politique spatiale nationale et on ne compte
que cinq agences spatiales sur le continent, au Nigéria, en Afrique
du Sud, en Algérie, au Maroc et en Égypte.
A l’heure où les découvertes scientifiques et technologiques, y
compris celles issues de l’exploration spatiale, vont conduire à des
avancées dans le secteur de l’agriculture, de la médecine, engen-
drer une hausse des revenus et ouvrir la voie à des innovations
inimaginables dans un futur proche, l’Afrique ne peut pas se per-
mettre de rester à la traîne.
Le continent aura cependant besoin à la fois d’un formidable lea-
dership pour mettre réellement la science et la technologie au service
du développement durable et de l’implication de tous les acteurs clés
dans l’élaboration et la mise en application des politiques en la ma-
tière. Cela pour garantir que ces politiques visent prioritairement les
besoins spécifiques des utilisateurs et des clients.
c
Dr. Mohamed IBN CHAMBAS
Brazzaville, République du Congo. Des spécialistes d’institutions nationales
évaluent le concept de modèle horizontal proposé par l’étude SAGA-EO. Ils
partagent les données d’observation de la Terre et leurs savoirs pour élaborer
des informations à valeur ajoutée afin d’aider à mieux gérer une crise alimentaire.
© J.G. Planès/Thales Alenia Space
120 - Développement Durable en Afrique & Satellites