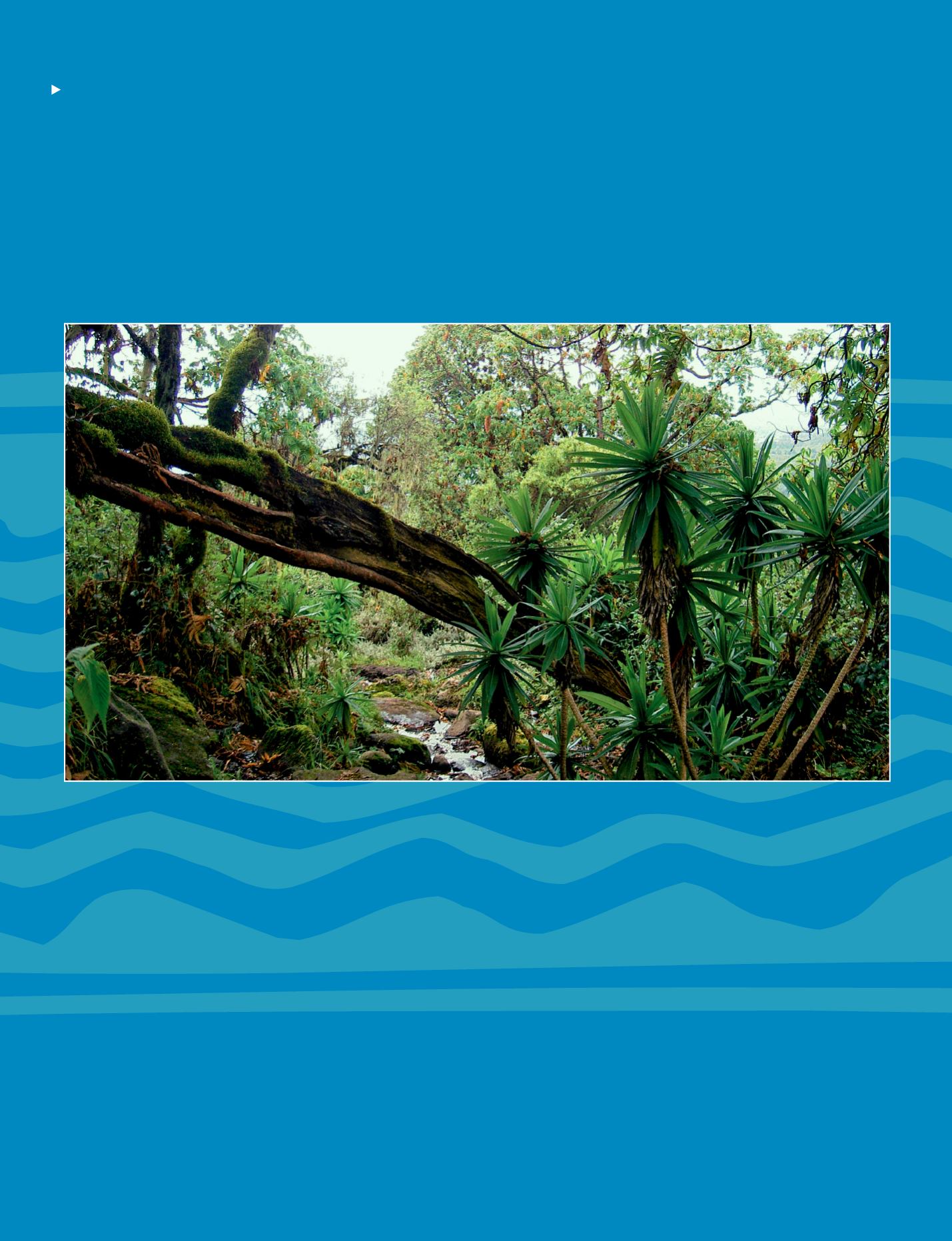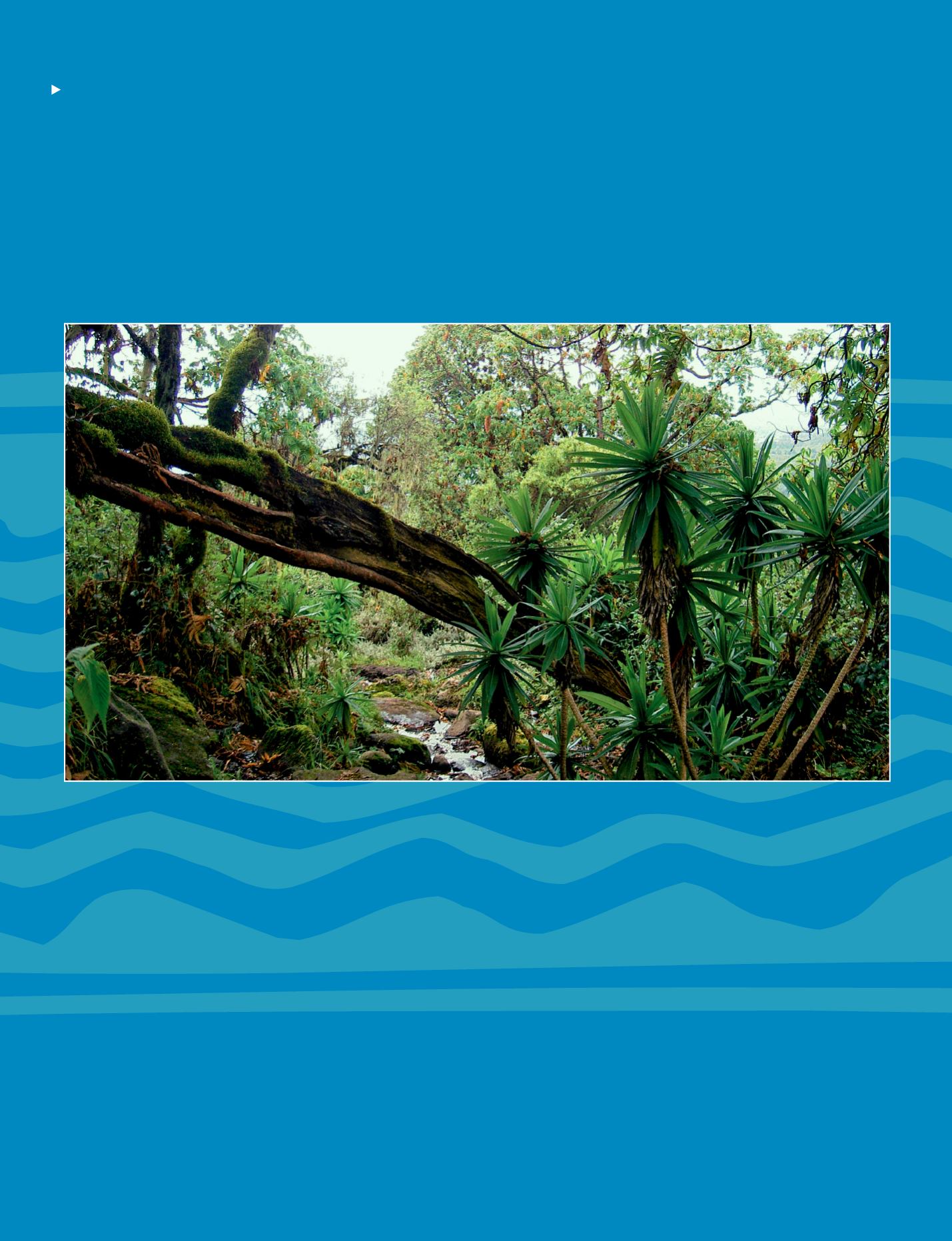
Sur les côtes de l’Atlantique ou de
l’océan Indien, des courants marins froids
—Canaries et Benguela — favorisent l’éclo-
sion d’une faune aquatique extrêmement
diversifiée. Au large de côtes de Guinée et
de Somalie, des courants chauds sont la
principale source de vapeur d’eau dans
laquelle puise la mousson et créent des
milieux secs et froids, ou chauds et pluvieux
selon les endroits .
Bien que reflet incontestable des facteurs
géographiques, le climat de l’Afrique reste
difficile à définir, sachant que la meilleure
manière de le faire repose sur des relevés
pluviométriques et leur distribution dans le
temps. Son impact se fait néanmoins sentir
sur pratiquement tous les aspects de la vie
socio-économique : rendements agricoles,
disponibilité des ressources naturelles,
santé humaine et animale, pour ne citer
que ces éléments.
L’Afrique recèle d’immenses richesses,
tant sur le plan géographique qu’écono-
mique. Paradoxalement, hormis quelques
pays émergents, elle reste constituée de
pays en développement. Ses économies
font d’elle une région socialement vulné-
rable, où la majorité de la population ne
dispose que de faibles revenus.
Endehors de la cueillette, de la chasse, de la
pêche et de l’élevage, celui de prestige pratiqué
par lesPeul, lesBoro-Boroet lesMassaï, l’agri-
culture assure les besoins fondamentaux
en alimentation des populations. Elle est
cependant vulnérable, eu égard aux cala-
mités naturelles comme la sécheresse et
les inondations. Et, lorsque surviennent
une invasion des criquets ou des erreurs
humaines comme les feux de forêts, les
cultures alimentaires, vivrières, se révèlent
totalement vulnérables.
D’importants dégâts sont alors causés
aux productions agro-sylvo-pastorales, des
perturbations socio-économiques et envi-
ronnementales apparaissent avec, comme
conséquences, les déficits alimentaires
récurrents, la disette, la pauvreté, l’exode
rural, la macrocéphalie des capitales, le
chômage chronique de la jeunesse, l’émi-
gration, l’inflation et les révoltes sociales.
L’espoir serait-il à rechercher dans l’inté-
gration comme semblent le prôner certains ?
Cela reste une des questions fondamentales
posées par la situation de l’Afrique, dans la
mesure où l’indépendance effective reste
encore à confirmer et à consolider comme
solution de rupture nette avec les pratiques
néocoloniales. Cela pour mettre enfin en
œuvre des politiques de développement
novatrices, au travers d’une intégration par
de grands ensembles sous-régionaux dans
tous les domaines et cela dans une dé-
marche de "participation inclusive" et de
démocratie économique et sociale (M.F.
Niang). La solution doit, en effet, être
nécessairement recherchée, pour le long
terme, dans la création ou le renforcement
de mécanismes supranationaux autour
de la coopération régionale et l’action mul-
tilatérale, tout en se référant aux progrès
apparents que sont, dans un tout autre
ordre, la CEDEAO et l’UEMOA.
“L’image de l’Afrique est fortement
conditionnée par le regard ethnocentrique
des occidentaux depuis Hérodote” (A.Berre).
Quatre siècles d’esclavage et de déportation
vers les Amériques (voir p.18), ainsi qu’un
passé colonial récent ont renforcé cette
perception réductrice qui, déjà en gestation
sous l’Antiquité, s’est longtemps cristallisée
avant de donner naissance à un complexe
de supériorité des occidentaux vis-à-vis de
ce continent.
Marquée par ce passé, l’Afrique a vu sa
culture - véritable vitrine de toute civilisation
-, d’abord niée, puis admise comme une
culture primitive, sans pensée logique et
gouvernée par l’émotion : auteur de l’
Essai
sur l’inégalité des races humaines,
Gobineau
(1853-1855) ne réduit-il pas l’art africain à
une manifestation inférieure de la nature
des noirs ? Or, à travers l’expression de ses
paysages, diversement riches, l’Afrique a
inspiré et fait éclore, depuis des millénaires,
une véritable mosaïque culturelle.
En effet, loin d’être monolithique, elle
n’est pas, non plus, mono ethnique, ni mono
culturelle. Il existe, certainement, autant, si
ce n’est plus, de différences, entre un Boro-
Boro, un Bamiléké et un Sénoufo, pour ne
citer que ces trois groupes, qu’entre un
Albanais, un Allemand et un Portugais.
14 - Développement Durable en Afrique & Satellites
Forêts de montagne, Mont Kenya (5 199 m). Montagne sacrée pour les communautés vivant dans cette zone, le deuxième plus haut sommet d’Afrique a été
reconnu par la Commission du patrimoine mondial de l’UNESCO comme "un des paysages les plus imposants d’Afrique de l’Est".
© Chris 73