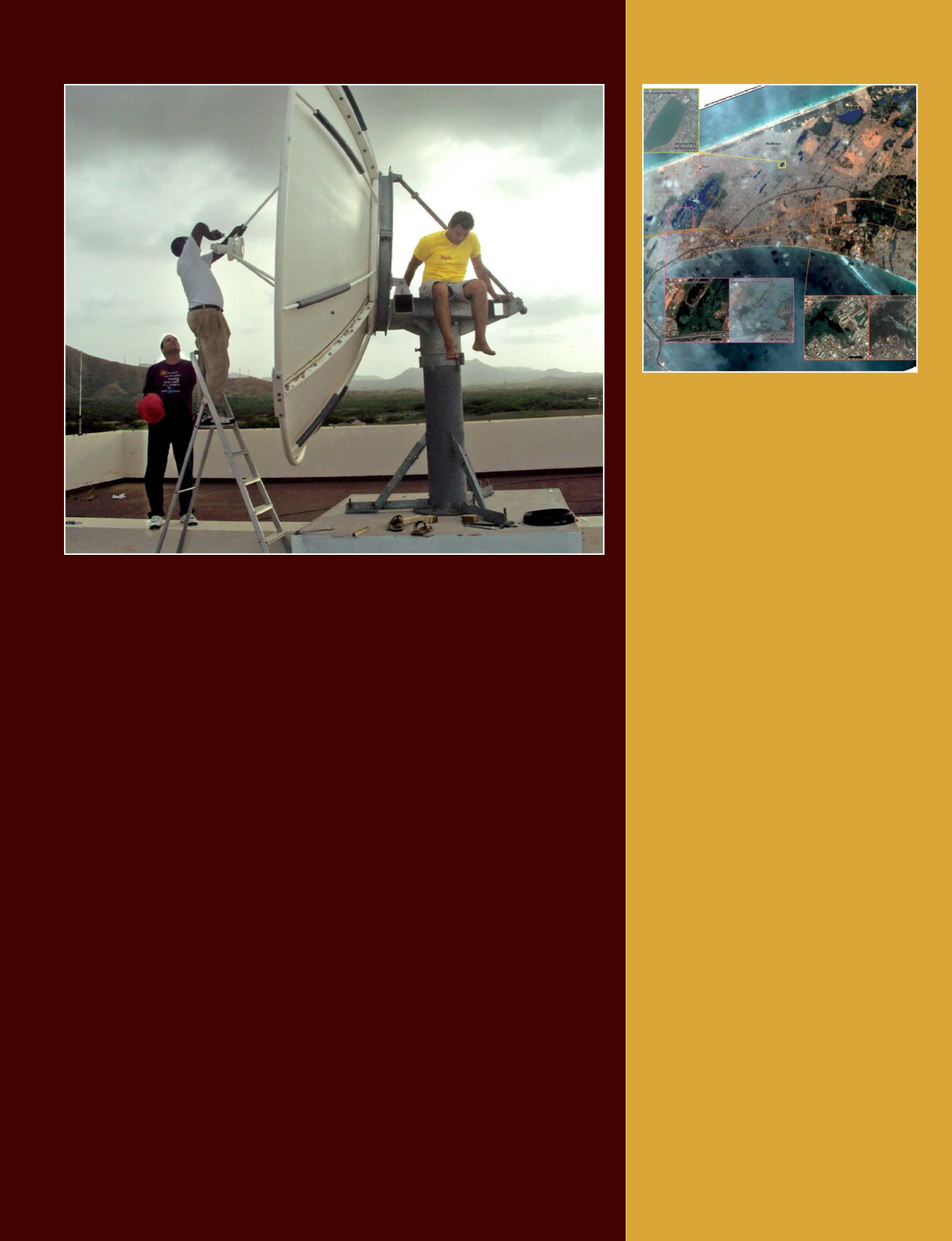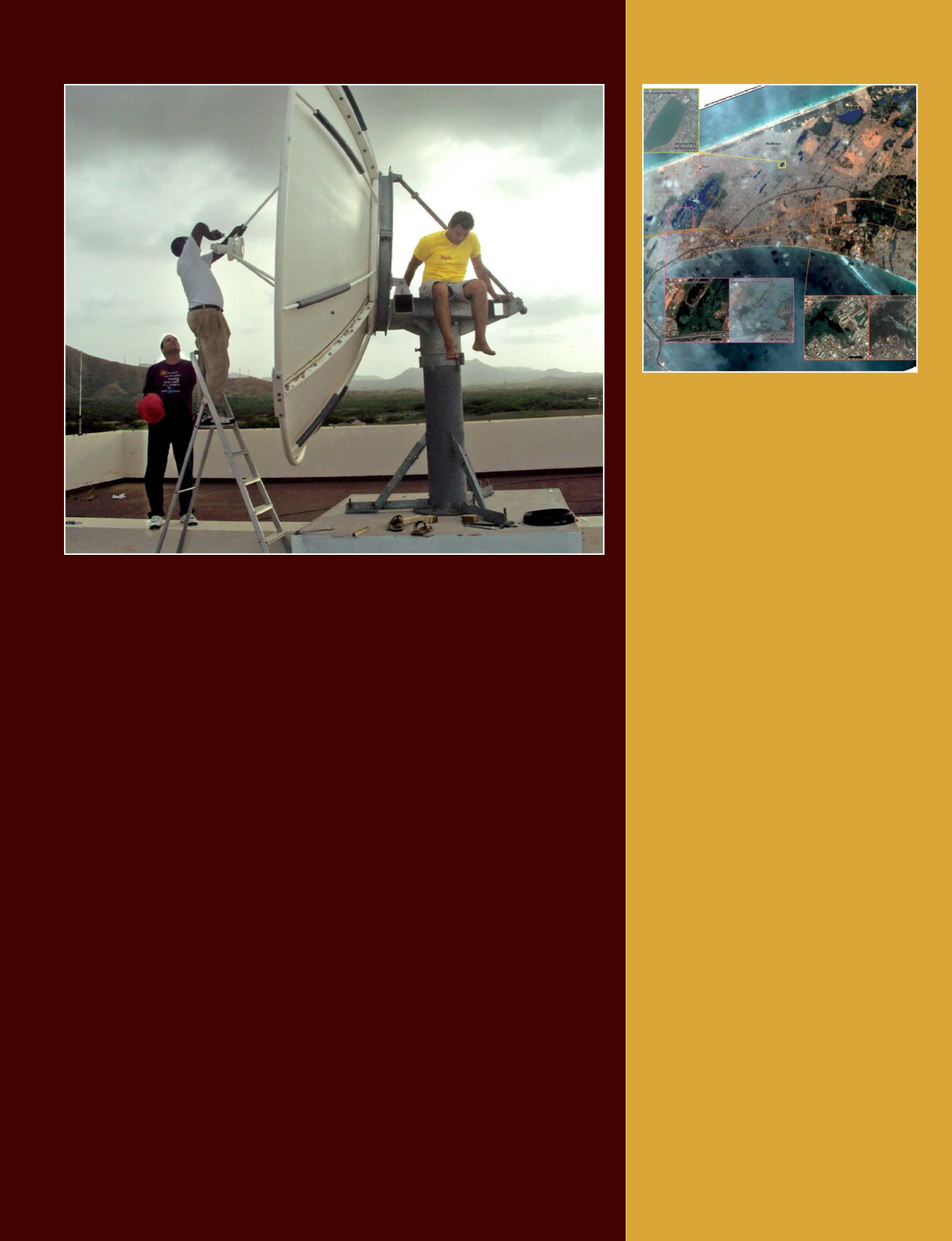
Installation de la station AMESD dans les locaux de l’INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das
Pescas) à Cabo Verde, octobre 2010. L’application principale est la surveillance des pêches.
© Telespazio
témoigne du chemin à parcourir : si les
centres de recherches régionaux amélio-
rent l’intégration des données spatiales,
nous restons loin d’un accès généralisé aux
centres de recherches nationaux spécialisés
ou aux laboratoires des universités. Or,
sans ces informations qui peuvent combler
des lacunes résultant des manques en
infrastructures, les recherches appliquées
resteront limitées. C’est le cas pour de
nombreuses cultures sur le continent et
notamment pour le cacao en Côte d’ivoire.
Les chercheurs ne disposeront pas de
toutes les informations agropédoclima-
tiques locales définissant chaque région
productrice. Ils ne pourront donc pas
maîtriser toute l’évolution de la biodiversité
locale, élément indispensable à la compré-
hension des agroécosystèmes sur lesquels
reposent de nouvelles techniques agricoles.
Autre défi, la transmission des savoirs
aux producteurs et à leur encadrement. Il
est indispensable d’intégrer ces besoins
aux stratégies élaborées. Pour la Côte
d’Ivoire, il en va du maintien de son rang
de premier producteur mondial de cacao,
une ressource qui assure les revenus d’un
tiers de sa population.
Espace et sécurité alimentaire
Ces réflexions s’appliquent aussi aux
cultures vivrières (igname, mil, etc.) pour
mieux maîtriser l’évolution des facteurs de
production ou les capacités de prévision
des récoltes. De nombreux pays africains
disposent de ressources humaines de qua-
lité dans les domaines de la télédétection et
de la recherche scientifique. Mais, face à la
croissance démographique et à la montée
des facteurs de stress environnementaux, il
est urgent de renforcer l’utilisation des ap-
plications spatiales et de permettre aux ac-
teurs de la recherche appliquée d’y accéder.
L’élaboration de programmes de recherches
orientés vers les besoins des producteurs
en milieu rural passe en effet par l’enrichis-
sement des bases de données environne-
mentales dont ils ont la charge.
Promouvoir la recherche scientifique
environnementale reste impératif pour
perfectionner les connaissances agropédo-
climatiques des régions productrices et
déterminer des itinéraires techniques agri-
coles adaptés. Ceci ne se réalisera pas sans
uneprisede consciencedes décideurs politiques,
qui permettront aux chercheurs de disposer des
outils qui transformeront l’insécurité alimen-
taire en opportunité de développement.
c
Cédric Lombardo
Directeur associé
BeDevelopment Consulting
Abidjan
Côte d’Ivoire
Données spatiales
et catastrophes
La Charte internationale Espace et
Catastrophes Naturelles vise à fournir un
système unifié d’acquisition et de diffusion
de données spatiales aux victimes de catas-
trophes naturelles ou d’origine humaine, via
des Utilisateurs Autorisés. L’objectif est de
contribuer à atténuer leurs répercussions
sur la vie des gens et sur leurs biens. La
Charte mobilise des agences dans le monde
entier (dont le CNES et l’ESA), bénéficie de
leurs savoir-faire et de leurs satellites à tra-
vers un point d’accès unique qui fonctionne
24 heures par jour, 7 jours sur 7, sans frais
pour l’utilisateur. Elle a par exemple été ac-
tivée le 25 août 2013 pour venir en aide au
Sénégal, à Dakar, (image ci-dessus) et à
Saint-Louis, puis le 8 novembre en Indonésie
suite au typhon Haiyan.
GEO collabore avec la Charte depuis
2009 en mettant l’accent sur les usagers
pour les cas de catastrophes dans les États
membres de GEO. Cette collaboration se
concentre sur la sensibilisation des utilisa-
teurs et les méthodes pour favoriser un
accès plus large à la Charte. GEO a ainsi
contribué à favoriser l’approbation du prin-
cipe d’accès universel par les membres de
la Charte. Toute autorité nationale de gestion
de catastrophe pourra désormais lui sou-
mettre des demandes pour une intervention
d’urgence. Des procédures appropriées
devront naturellement être suivies, mais le
pays touché ne devra pas être obligatoire-
ment membre de la Charte.
Cette carte de la Charte montre la situation observée
par Pléiades HR1B à Dakar (Sénégal) le 28 août 2013
lors des inondations. Ce satellite du CNES est équipé
d’un instrument optique réalisé par Thales Alenia
Space.
© CNES 2013 - Distribution: Astrium Services
/ Spot Image S.A., droits réservés. Carte produite par le
SERTIT (Strasbourg).
Outils spatiaux - 37