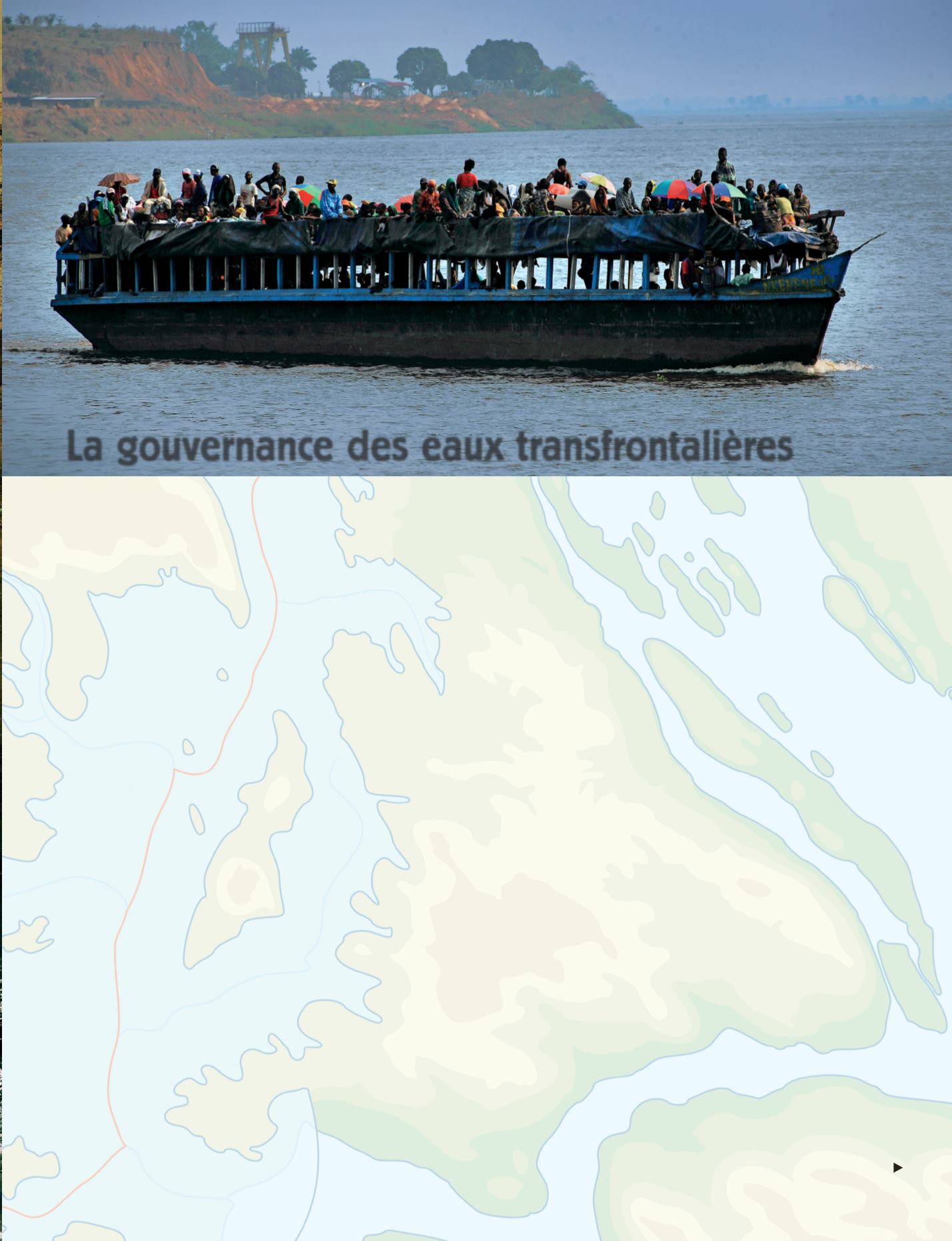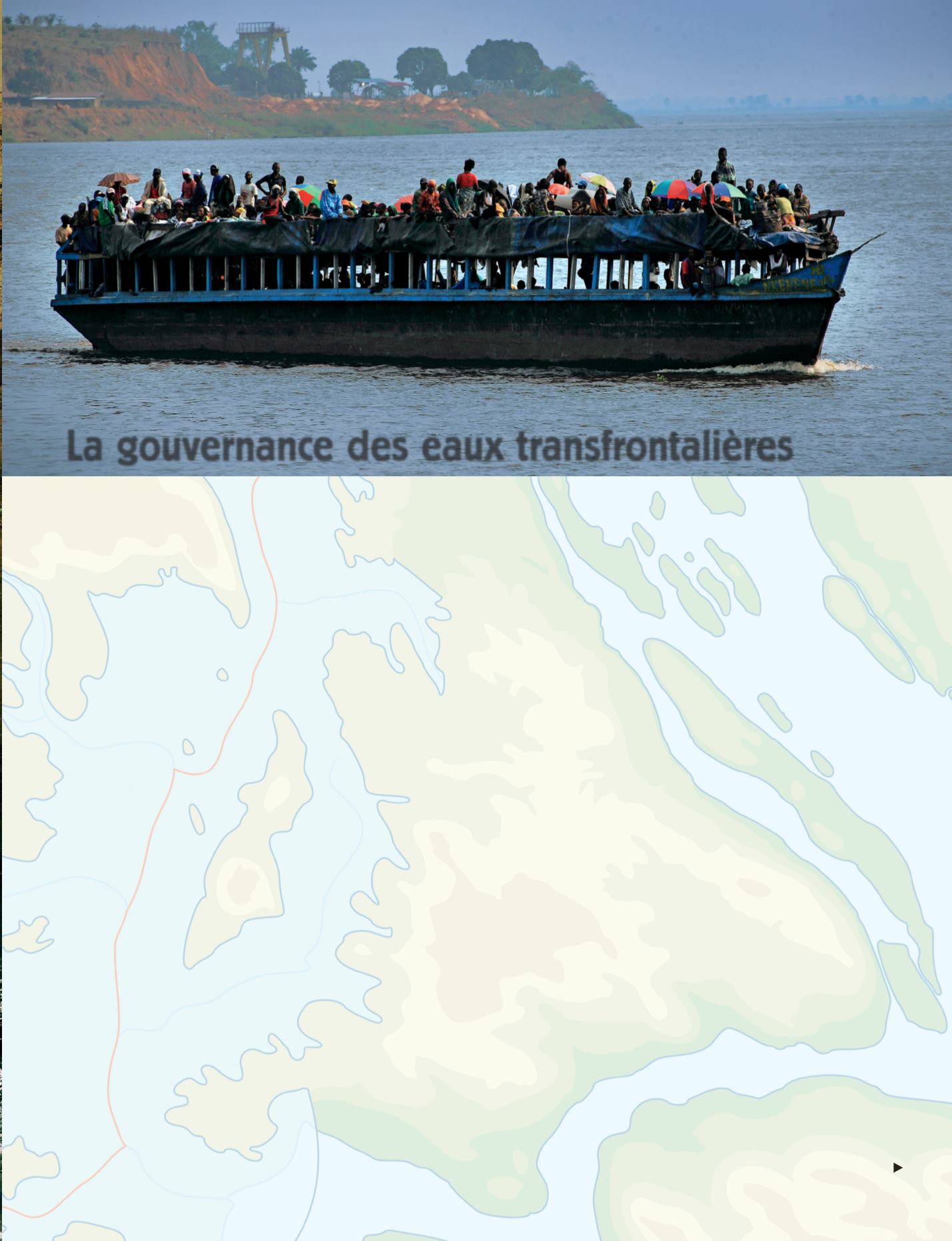
R
éduire de moitié le pourcentage de la
population exposée à la pauvreté, à la
malnutrition et privée d’accès à l’eau
potable est un des "Objectifs du Millénaire".
En 2002, le sommet de Johannesburg y a as-
socié l’enjeu de l’assainissement et le G8
d’Evian s’est engagé à soutenir le NEPAD
(Nouveau Partenariat de Développement de
l’Afrique), qui considère l’eau comme un défi
majeur à relever. Enfin l’Afrique a été reconnue
par le GIEC comme étant un continent parti-
culièrement vulnérable dans ce domaine. Il
est donc impératif pour tout gouvernement
africain de gérer les impacts du changement
climatique sur les ressources en eau.
D’autre part, la pollution de ces ressources
reste un problème majeur qui mérite une at-
tention particulière. Notre avenir en dépend,
d’autant que l’abondance des ressources
naturelles constitue un très fort potentiel en
matière d’aménagement et de développe-
ment économique régional.
L’Afrique centrale est caractérisée par
un vaste bassin transfrontalier d’environ
3 822 000 km
2
classé au deuxième rang
mondial par sa taille et son débit, après
celui de l’Amazone. Bien qu’au cours des trois
dernières décennies la partie septentrionale
ait subi une baisse des précipitations, cela
fait de cette région l’un des châteaux d’eau
du monde. Elle abrite également 60% de la
biodiversité de toute l’Afrique.
La protection des ressources naturelles
de l’Afrique centrale, en particulier de l’eau,
constitue donc un enjeu économique majeur,
notamment pour la navigation, la pêche,
l’agriculture, l’alimentation en eau potable,
l’irrigation, l’hydroélectricité…Elle contribue à
lutter contre le changement climatique via
la conservation et la restauration du deu-
xième massif forestier de la planète après
l’Amazonie. Ces écosystèmes sont le sup-
port d’activités socio-économiques qui dé-
pendent étroitement de la qualité de ces
milieux (habitants autochtones de la forêt
de la Cuvette centrale)
Le problème majeur pour améliorer la
gestion de ces ressources en eau est de
s’assurer que les plans s’alignent sur les
stratégies nationales de développement et
de réduction de la pauvreté tout en amélio-
rant la capacité à gérer les défis courants de
la variabilité climatique pour répondre à
long terme aux impacts du changement
climatique.
Un potentiel qui reste à exploiter
Instaurer la confiance, partager nos
connaissances et la vision du bassin au-
delà des frontières est le socle de la mise
en œuvre de la Gestion Intégrée des Res-
sources en eau dans les zones hautement
vulnérables et celles sujettes à des conflits.
Les Chefs d’États du Cameroun, du Congo,
de la Centrafrique et de la République
démocratique du Congo ont créé en 1999 la
Commission Internationale du bassin
Congo – Oubangui - Sangha (CICOS) avec
comme mandat "la promotion de la navigation
intérieure". Sa mission a été élargie en 2007 à
la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE) et un Plan d’Action Stratégique
élaboré. Les quatre états membres de la
CICOS occupent 83 % de la superficie du
bassin versant du fleuve Congo et l’Angola,
observateur à la CICOS depuis 2007, 8 %. Les
autres pays du bassin sont la Zambie et la
Tanzanie, ainsi que, dans une moindre
mesure le Burundi, et le Rwanda. Le Gabon
a également rejoint la CICOS en qualité de
membre effectif.
Le potentiel hydroélectrique du bassin
du Congo pour l’alimentation énergétique
de l’Afrique centrale et de l’ensemble du
continent africain n’est plus à démontrer.
Source d’énergie renouvelable éminemment
rentable, il reste pourtant très peu exploité.
La puissance actuellement installée n’est
que de 4 667 MW pour un potentiel estimé à
plus de 150 000MW dont 100 000 MW pour la
seule République démocratique du Congo.
La capacité du site d’Inga atteint 44 000 MW
mais seulement 3 % est installée. Le taux de
desserte en électricité demeure bas, en
particulier en milieu rural pour ce qui
concerne les quatre états membres de la
CICOS : au niveau régional de l’Afrique cen-
trale, le taux d’électrification est de 13 %, la
consommation par habitant reste très faible
(109 kWh/hab).
L’exploitation de ce potentiel dépend
directement des infrastructures hydrau-
liques qui pourront être aménagées sur le
bassin du Congo en fonction des données
hydrologiques. La connaissance de la res-
source constitue la base de toute gestion
des eaux : on ne gère que ce que l’on
connaît. Les données hydrologiques sont
La gouvernance des eaux transfrontalières
Le Congo est un vaste pays avec à peine plus de 480 km de routes goudronnées. Les gens préfèrent prendre des bateaux, souvent surchargés, ce qui provoque
des accidents. Ici, à Maluku, à environ 80 km de Kinshasa. Des projets de réhabilitation et d’amélioration de la navigabilité du bassin du Congo sont à l’étude.
© J. Ladel
Eau - 43