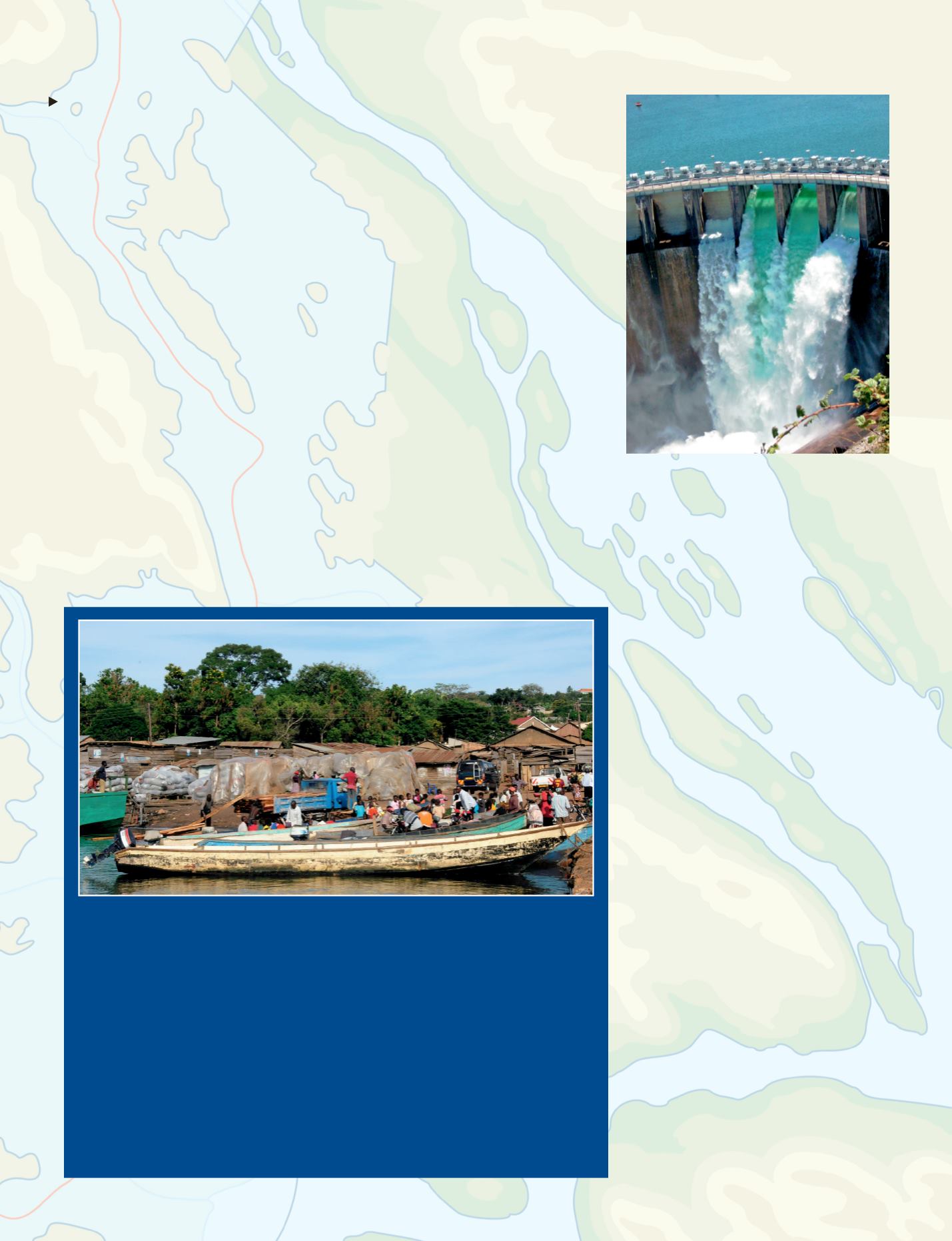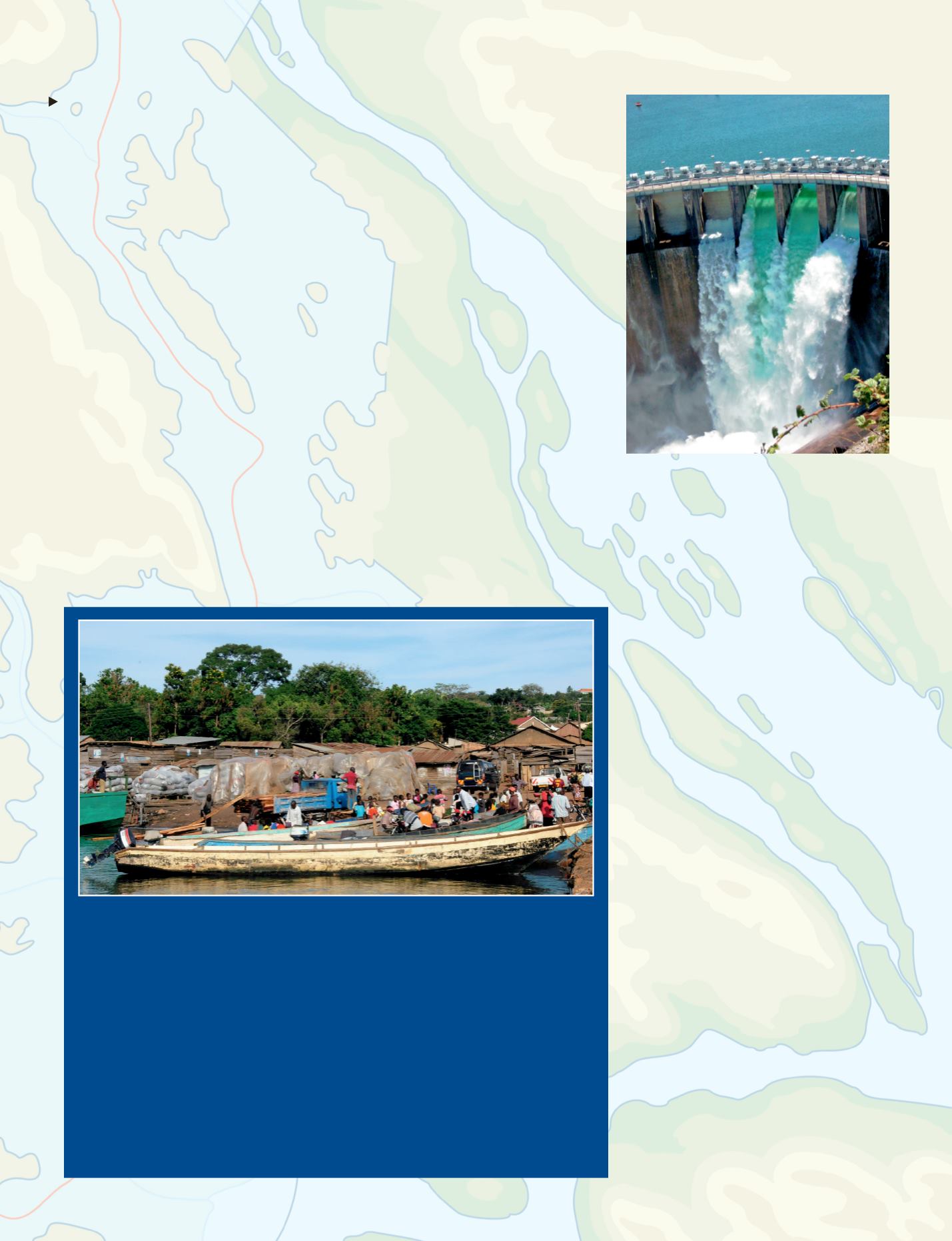
également la base de toute planification, du
dimensionnement et de la gestion des
infrastructures hydrauliques.
Le suivi des niveaux d’eau est en particu-
lier indispensable à la navigation, surtout du-
rant les périodes d’étiage. Sur les centaines
de stations hydrométriques historiques du
bassin, seule une vingtaine sont aujourd’hui
opérationnelles. Ceci s’explique en particu-
lier par les années d’instabilité politique et
de conflits dans la sous-région et le manque
d’entretien par les gestionnaires nationaux
de ces stations.
Les pays de la région éprouvent par
ailleurs des difficultés eu égard à la pro-
duction et la diffusion des informations
hydrologiques. Ceci découle du fait que les
systèmes d’acquisition, de traitement et
d’archivage sont inadaptés, voire inexis-
tants. Les autres difficultés majeures sont
relatives aux carences technologiques,
notamment celles du réseau de télécom-
munication, et aux faiblesses de la poli-
tique de coopération régionale d’échange
de l’information.
Le enjeux techniques et scientifiques
sont considérables. L’ESA a lancé en 2002
l’initiative TIGER pour contribuer à la
recommandation du sommet mondial sur
le développement durable. Objectif : assister
les pays africains dans le domaine de la col-
lecte, de l’analyse et de la dissémination de
la géo-information relative à l’eau et s’ap-
puyant sur les technologies d’observation
de la Terre. Elles permettent de pallier la
faiblesse des infrastructures de collecte
des données
in situ
, rendant possible une
gestion détaillée des ressources. TIGER
pourrait également donner une vue générale
homogène de larges régions, facilitant ainsi
l’intégration de l’information du niveau
local au niveau national et à l’échelle trans-
frontalière, incluant les zones éloignées,
inaccessibles et peu sécurisées.
Outre l’initiative TIGER, les pays d’Afrique
centrale participent au programme AMESD
via la thématique “Gestion des Ressources
en Eau”. Deux services opérationnels sont
à développer par la CICOS chargée de l‘éla-
boration d’un système d’alerte des étiages
sur l’Oubangui pour les navigants, ainsi que
le suivi du cycle hydrologique de son sous-
bassin et du plan d’eau sous forêt de la
cuvette centrale. La mise en œuvre passe
par le recours aux données d’altimétrie
spatiale issues des missions d’ENVISAT et de JASON 2. Leur développement sera focalisé
dans un premier temps sur l’Oubangui, un
des principaux affluents du fleuve Congo
dont la vulnérabilité à la variabilité clima-
tique est la plus accentuée sur l’ensemble
du bassin. Ces services opérationnels
pourraient être utilisés par de nombreux
usagers dans les domaines de la navigation,
de l’environnement et de l’aménagement, la
planification, la production d’hydroélectricité,
Pour cela, il est indispensable de mettre
en place des infrastructures hydrauliques
de taille importante en tenant compte des
effets en aval. Tout aménagement a en effet
des effets interactifs en différents points de
ce bassin, actuellement en grande partie
vierge d’aménagement. Les pays ont donc
comme devoir :
• D’optimiser le choix des aménage-
ments à l’échelle de l’ensemble du bassin.
• D’évaluer les impacts cumulés de ces
aménagements, surtout pour les projets
transfrontaliers.
• De prendre en compte les impacts
envisageables du changement climatique.
La valorisation de nos ressources en
eau passe nécessairement par la prise en
compte de ces contraintes.
c
Georges Gulemvuga
Directeur des ressources en eau de la
Commission Internationale du Bassin
Congo-Oubangui-Sangha,
Kinshasa/Gombe
République démocratique du Congo
Qualifiés d’“éléphants blancs”, les barrages
d’Inga ((RDC) ont une capacité de 44 000 MW mais
seulement 3 % est installé. Relancé en 2013, le
projet Grand Inga est censé fournir l’électricité pour
toute l’Afrique subsaharienne. Coût de la première
tranche : 12 milliards de dollars.
©D.R
Voies navigables : des opportunités
Le bassin du Congo offre 25 000 kilomètres de voies navigables. Dans son aire de
développement la navigation fluviale constitue un élément très dynamique du trans-
port commercial de charges lourdes et de marchandises en vrac. Du fait de la mise en
place d’une politique de croissance et de développement durables pour le corridor
Bassin du Congo-Atlantique, la route fluviale offre de grandes opportunités. Notam-
ment avec le développement de zones économiques spéciales, la promotion du com-
merce inter-rives et inter-régional et la libre circulation des biens et des personnes,
véritables catalyseurs du développement durable.
Colonel Benjamin Ndala
République du Congo
Ancien Secrétaire Général de la CICOS
44 - Développement Durable en Afrique & Satellites