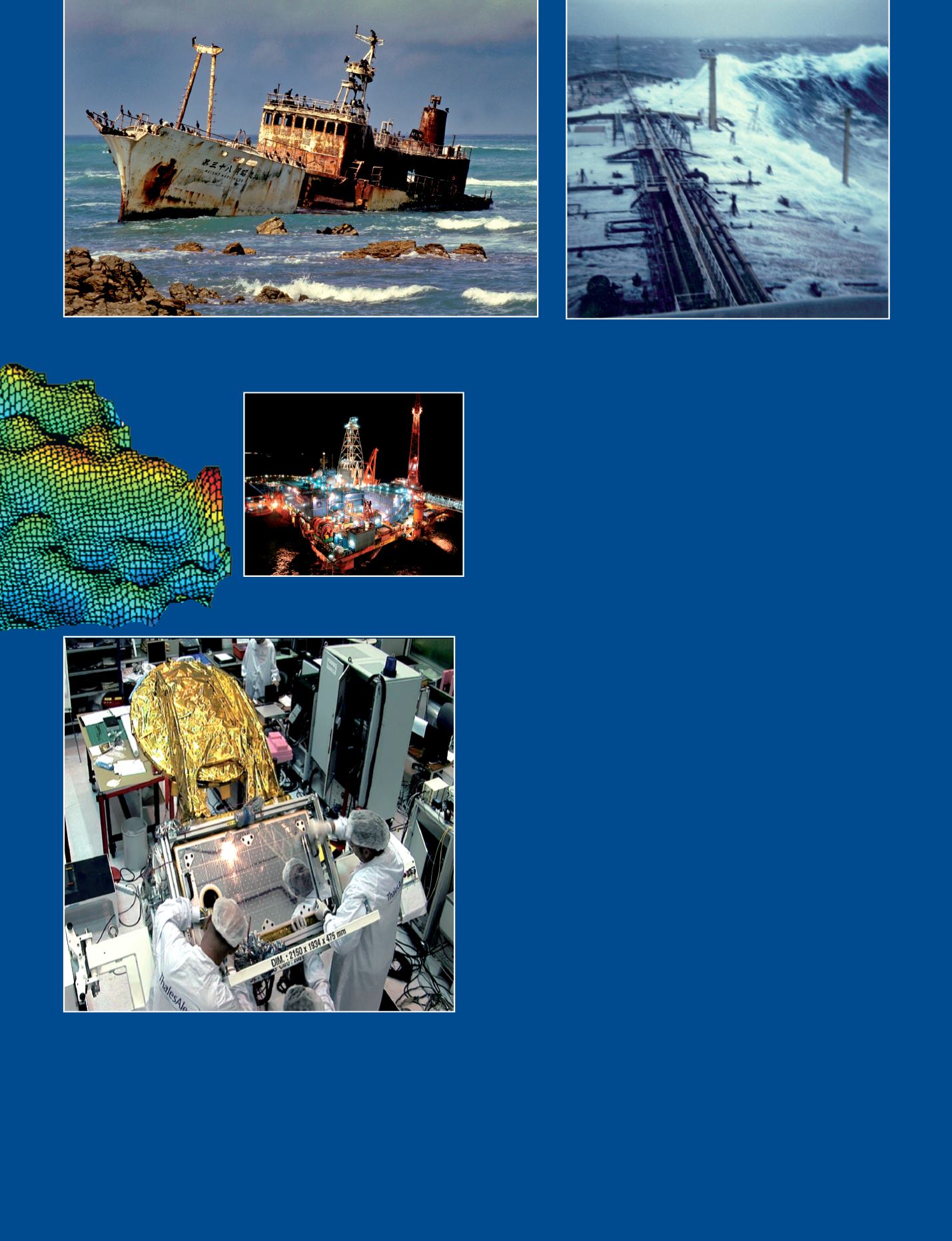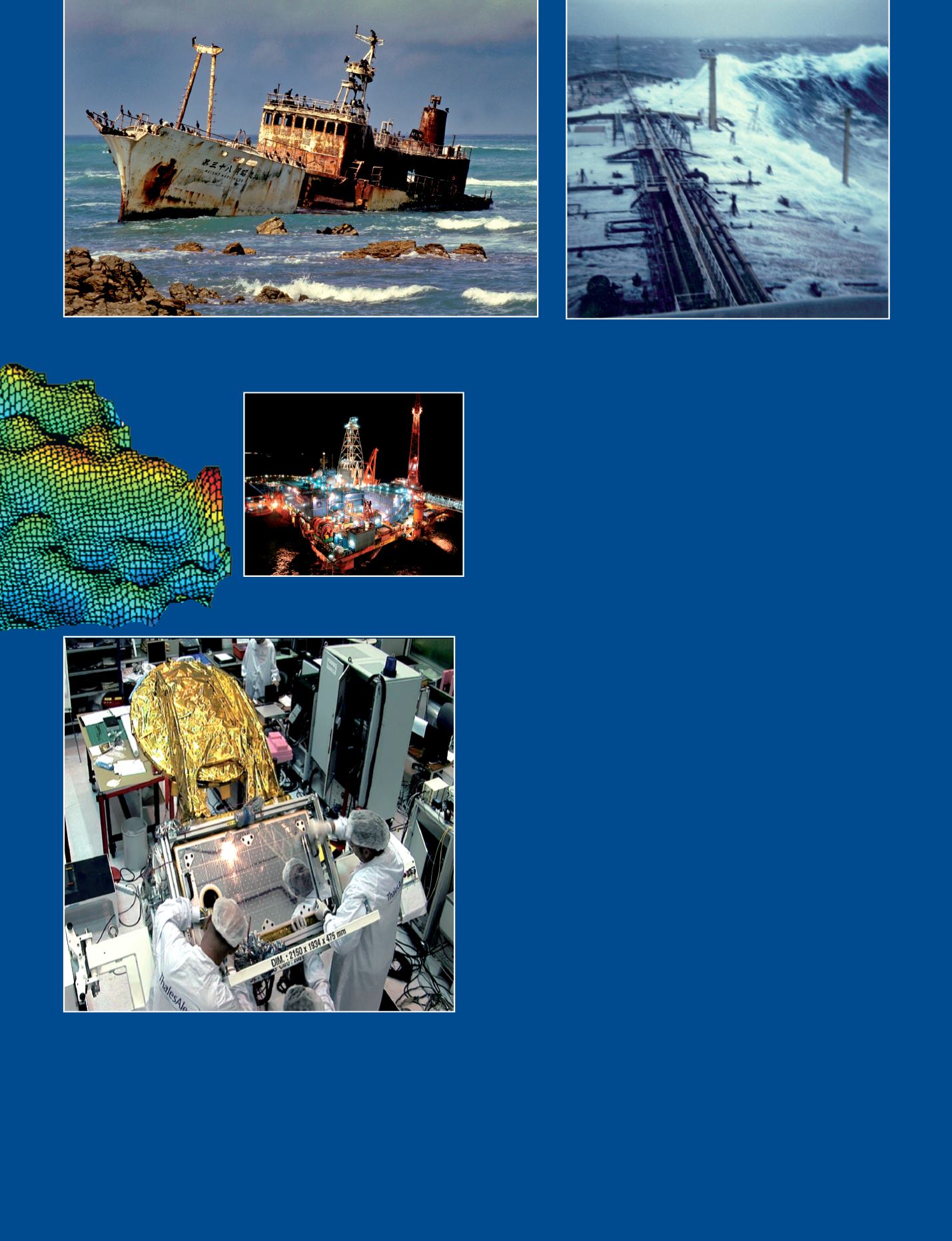
Ci-dessus, Le thonier japonais Meisho Maru a fait naufrage en 1982 au Cap Agulhas ("Cap des
aiguilles" en Portugais), bien connu pour ses " vagues scélérates". Les 17 membres d’équipage
ont regagné la côte à la nage. Cette pointe sud du continent africain est maintenant une des
attractions du Parc National d’Agulhas.
©D.R.
À droite, Une vague scélérate à l’assaut du supertanker Esso
Languedoc dans le courant des Aiguilles, au large de Durban,
Afrique du Sud en 1980.
© Philippe Lijour
Le champ pétrolier Rosa, à 135 km des
côtes de l’Angola, sur des eaux de 1350m
deprofondeur.
©D.R.
Coopération entre le CNES et l’ISRO (l’Agence spatiale indienne), le satellite
SARAL étudie les océans avec un altimètre en bande Ka. Ici, le module
charge utile lors de l’intégration.
Thales Alenia Space © Suds-Concepts
d’observation, ces compagnies peuvent mieux cerner les zones pour
lesquelles elles doivent se procurer ou bien acheter des données
sismiques. Afin d’encourager l’utilisation des ressources satellitaires
pour l’étude de l’environnement, un des nombreux objectifs de l’African
Association of Remote Sensing of the Environment (AARSE) est
la gestion des zones côtières. Les agences spatiales commen-
cent également à concevoir des produits altimétriques
dédiés à ces zones comme PISTACH (CNES), COASTAL (ESA),
ALTICORE (UE/INTAS) et le futur ALTICORE africain.
Le Réseau africain d’échange de données et d’informations
océanographiques (ODINAFRICA), rassemble plus de 40 institu-
tions de recherche marine de 25 pays africains. L’objectif de ce
réseau, avec son unité de gestion des données et de l’information
basée à l’Université du Ghana, est d’assurer aux usagers
africains l’accès aux données marines et côtières locales, régio-
nales et mondiales. Ce réseau agit en tant qu’organisme régional
de surveillance du niveau des océans. ODINAFRICA a également
mis au point l’Atlas marin de l’Afrique dans lequel les mesures
issues de marégraphes sont intégrées à d’autres données géo-
spatiales pour constituer une série d’atlas.
Grâce aux actions coordonnées par les programmes Réseau
d’Observation Marine et Terrestre Europe-Afrique (EAMNet),
Système d’Observation de l’Océan Global en Afrique (GOOS-Africa),
Surveillance de l’Environnement en Afrique pour un Développement
Durable (AMESD) et par d’autres instituts marins et universités
africains, une nouvelle génération de jeunes scientifiques pourra
davantage utiliser les données altimétriques. Le programme
AMESD, par exemple, élargit aux applications enmatière d’environ-
nement et de climat l’utilisation des données d’observation opéra-
tionnelles de la Terre à but météorologique.
Pour renforcer et élargir leur participation aux études en
cours sur le changement climatique, les pays africains dotés
d’agences spatiales (l’Algérie, l’Égypte et le Nigéria), pourraient
intégrer à leurs travaux de recherche les informations issues des
systèmes d’observation des océans. Cela permettrait aux cher-
cheurs ou aux universitaires africains de traiter tous les aspects
des études environnementales et de faire partie intégrante de la
collecte, de la diffusion et de la validation de données, toutes
essentielles pour la surveillance et la prévision des change-
ments environnementaux.
c
Dr Ibrahim Muhammed (Nigéria)
Dept. Suivi & Géoinformatique
École des Sciences Environnementales
Université de Technologie Modibbo Adama
le développement d’infrastructures nécessaires à la vie des
populations.
Un exemple est fourni par les grandes compagnies pétro-
lières et gazières qui utilisent les données gravimétriques fournies
par les satellites altimétriques pour localiser les bassins sédi-
mentaires au large. En les combinant avec d’autres données
Mers - 89