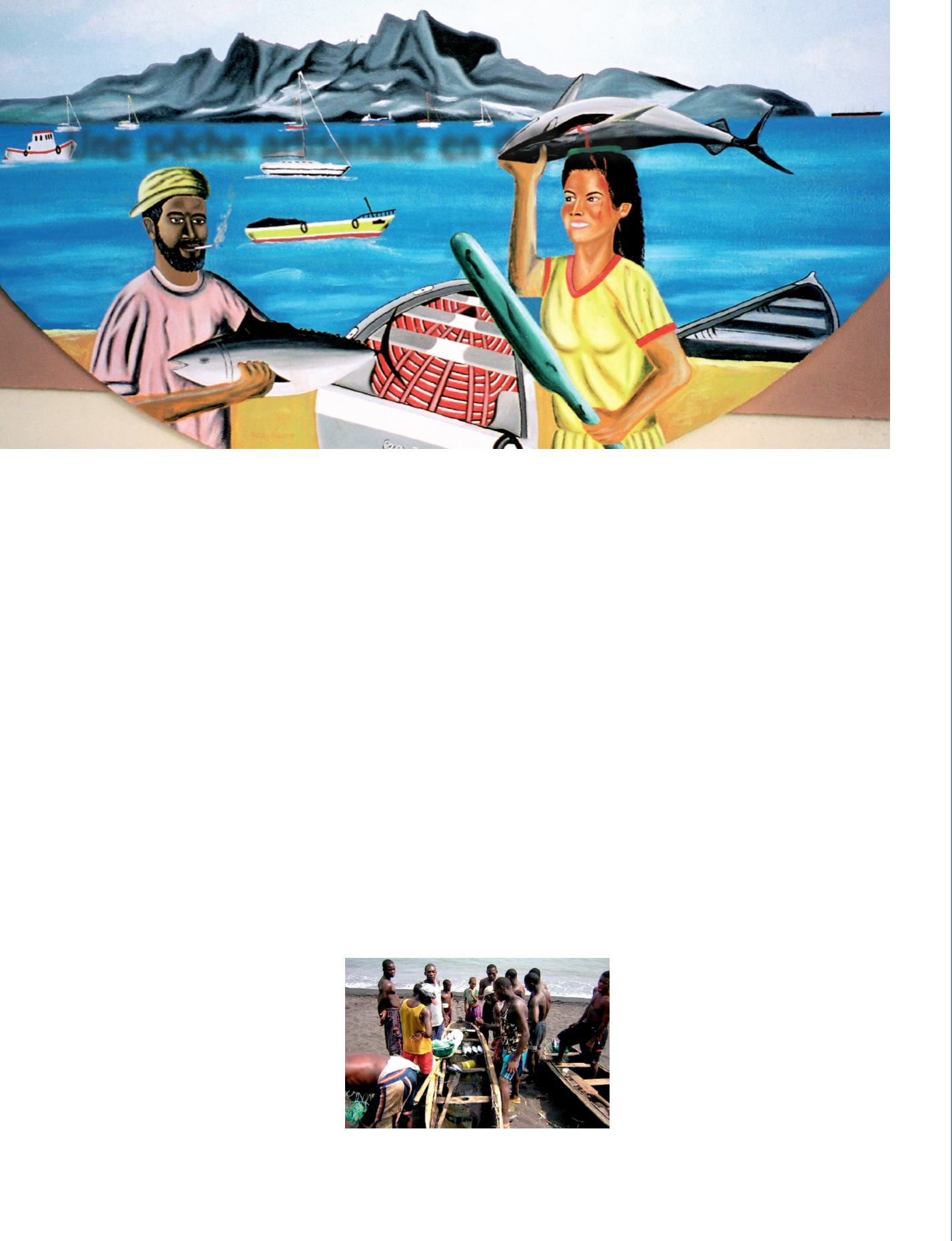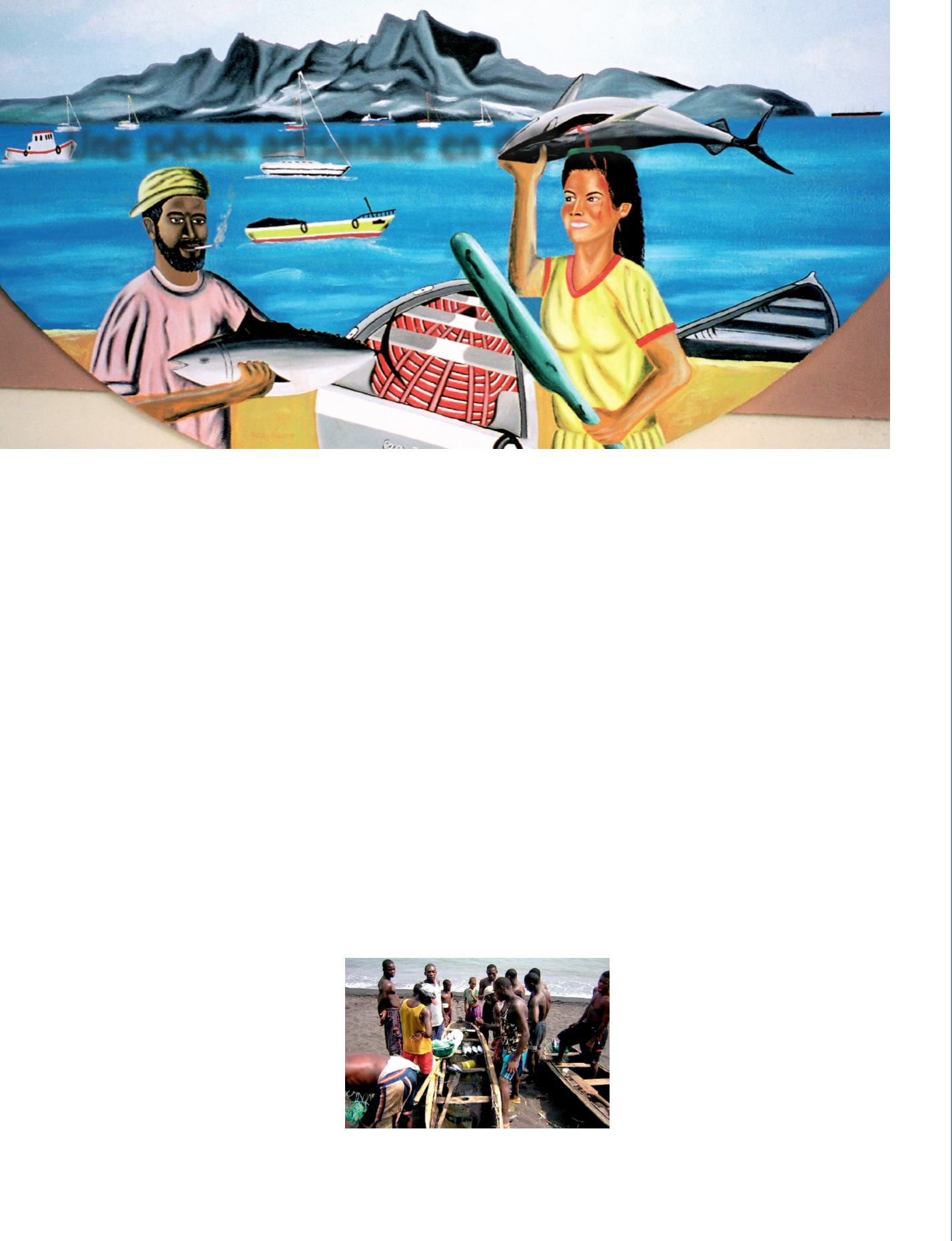
Une pêche artisanale en difficulté
S
ituéenAfriqueCentrale, sous l’Équateur,
São Tomé et Príncipe possède des res-
sources halieutiques qui pourraient
jouer un rôle important pour son économie et
son autosuffisance alimentaire. Cet archipel
dispose d’une Zone Economique Exclusive
(ZEE) de taille considérable pour la région
(160 000 km
2
). Elle concentre entre mai et
octobre une abondante ressource halieutique
du fait d’un brassage local des eaux du Golfe
de Guinée. La pêche artisanale apporte 70%
des protéines animales nécessaires à la po-
pulation et près de 30 000 personnes (20%
des habitants) en dépendent directement ou
indirectement pour leur survie. Pourtant, São
Tomé et Príncipe ne profite pas, ou très peu,
de la richesse de ses eaux et la pêche artisanale
subit une crise inévitable aux effets désas-
treux à court terme pour la population de ce
petit pays, parmi les plus pauvres de la planète.
Moderniser les pratiques
Premier écueil, l’état ne disposant pas de
moyens suffisants pour contrôler ce vaste
territoire maritime, cette ressource est pillée
par une flotte industrielle étrangère peu
scrupuleuse. Ensuite le manque de moyens.
La pêche reste pratiquée de manière artisa-
nale par des pêcheurs sous-équipés et peu
organisés. Avec leurs pirogues creusées dans
des troncs d’arbres, lourdes et peu maniables,
ils ne peuvent pas s’éloigner suffisamment
des côtes pour exploiter les abondantes
ressources pélagiques de la ZEE. S’ajoute
l’utilisation de techniques dévastatrices –
explosifs, senne tournante à l’aide de filets au
maillage trop fin – qu’une réglementation
trop timide ne parvient pas à encadrer. À
terre, les femmes mareyeuses, les "Palaiés",
Port de Santa Maria (Cap-Vert). Peinture murale montrant l’importance de l’activité de pêche de l’île, en particulier du thon.
© Marie-Noëlle Favier / Indigo / IRD
ont du mal à écouler le produit de la pêche :
absence demoyen de conservation du poisson
et faible capacité de transformation, conditions
d’hygiène insuffisantes dans les communautés
villageoises, étroitesse du marché local etc.
Depuis la fin des années 1990, la petite
ONG santoméenneMARAPA (Mar Ambiente e
Pesca Artesanal) tente malgré tout de renver-
ser la situation. Objectif : moderniser les pra-
tiques traditionnelles et dynamiser des fi-
lières de commercialisation. MARAPA a
réussi l’introduction d’embarcations indivi-
duelles à balancier, de type Prao, mieux
adaptées aux conditions de navigation. Elle
expérimente depuis plusieurs années l’utili-
sation de Dispositifs de Concentration du
Poisson (DCP) en haute mer, qui permettront
à terme aux pêcheurs disposés à s’éloigner
des côtes de maintenir un niveau de capture
raisonnable. Avec l’appui de différents parte-
naires, elle a réalisé de nombreuses actions de
sensibilisation et formation aux techniques
de pêche responsables et à la préservation
des écosystèmes marins et côtiers à l’échelle
nationale. Elle a diffusé auprès des ma-
reyeuses de meilleures pratiques de trans-
formation (séchage, salage, fumage) et de
valorisation des produits de la pêche.
Ces dernières années, avec l’appui de
l’État santoméen et du FIDA (Fonds Internatio-
nal pour le Développement Agricole), MARA-
PA a concentré son intervention sur la structu-
ration d’une filière de commercialisation du
poisson frais sous glace entre la capitale et
les zones de pêche isolées et plus produc-
tives du sud de l’île. Une coopérative de ma-
reyeuses reçoit ainsi depuis 2005 l’assistance
technique de l’ONG dans ce domaine.
Pérenniser les actions
MARAPA se heurte cependant à de nom-
breux obstacles, notamment à une forte
résistance aux changements au sein de com-
munautés villageoises aux traditions tenaces,
à laquelle s’ajoutent d’énormes difficultés lo-
gistiques dans un pays aux infrastructures
décadentes. Conséquence, les résultats de ce
projet restent mitigés et sa pérennisation
n’est pas garantie sur le long terme.
La pêche santoméenne n’a pourtant pas le
choix si elle veut survivre. Les pratiques
actuelles ne sont pas viables et l’on observe
déjà des signes d’essoufflement des res-
sources côtières. L’exode rural en cours vers
les zones urbaines côtières augmentera irré-
médiablement la dépendance alimentaire aux
produits de la pêche d’une population en forte
croissance. Au regard des enjeux, les actions
de MARAPA s’avèrent terriblement néces-
saires mais semblent bien insuffisantes.
c
Bastien Loloum Zuntabawé
Largo Bom Despacho
République Démocratique
de São Tomé et Príncipe
Le poisson provenant de la pêche artisanale
constitue la principale source de protéines
animales de São Tomé et Principe.
© MARAPA
86 - Développement Durable en Afrique & Satellites