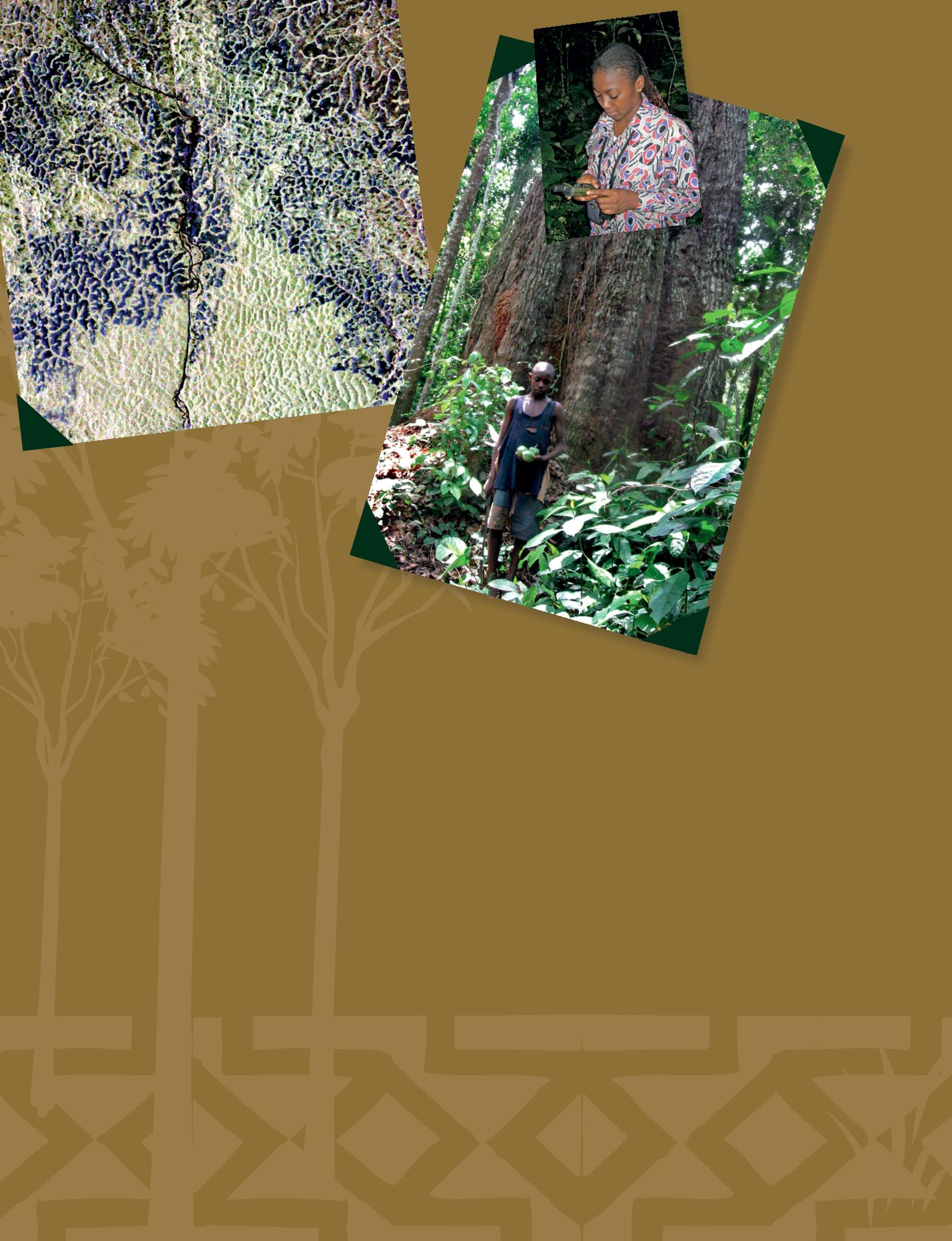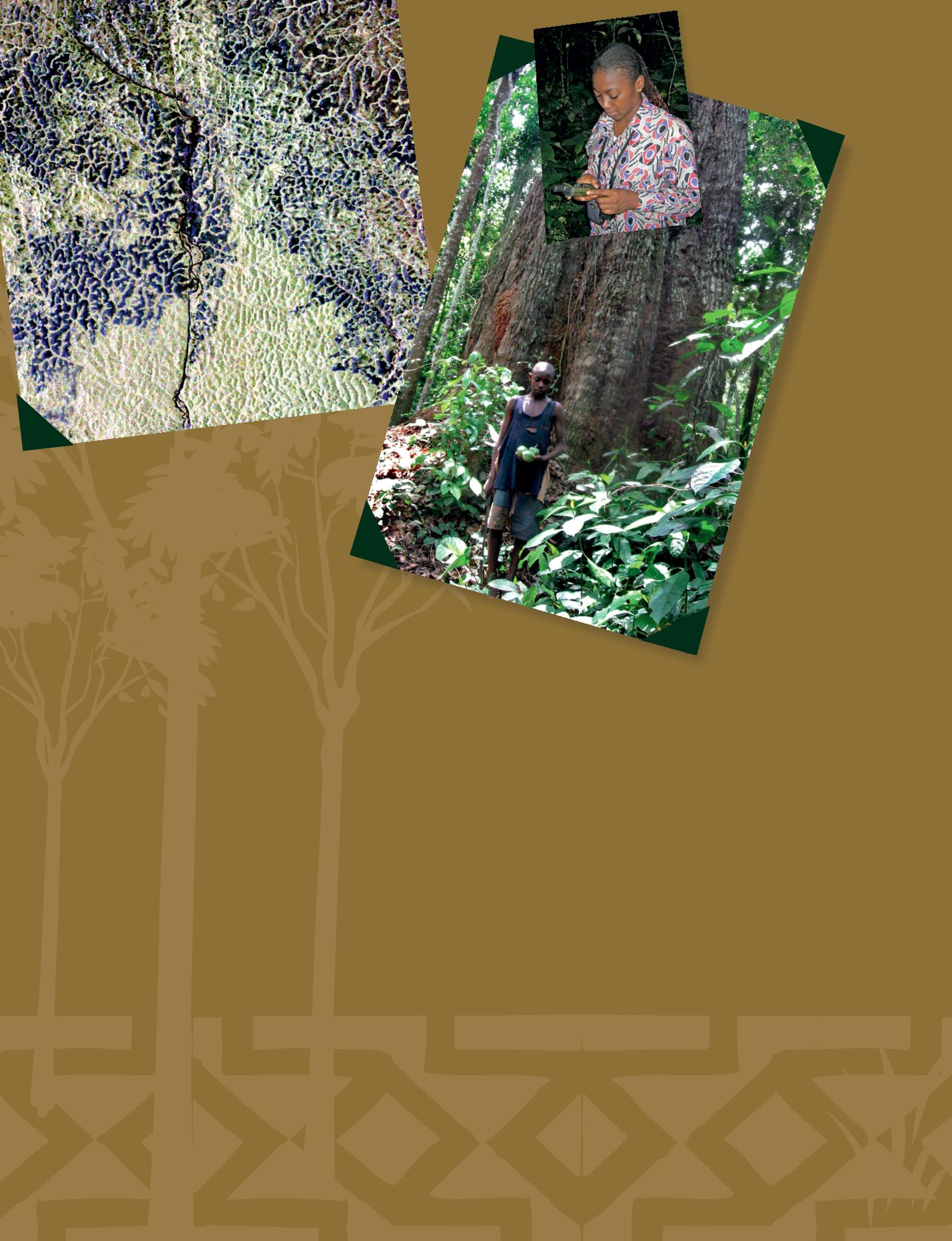
Image ALOS-PALSAR du site d’Adamawa au centre
du Cameroun. Mosaïque de deux séries d’images
acquises fin 2009 et fin 2010. Cette aire comprend
l’interface entre la forêt humide au sud (couleur verte)
et la savane (violet foncé) avec une étroite galerie
forestière dans le nord. Entre ces deux écosystèmes,
on voit une mosaïque de parcelles de forêts et de
savanes sur plateaux.
© CESBIO
toriaux. Après l’indépendance, la stratégie
commune de contrôle des forêts par les
États — qui a favorisé un droit d’accès in-
ternational — a consisté à ignorer, banali-
ser et négliger les savoirs et pratiques indi-
gènes, la plupart du temps délaissés au
profit de la "connaissance scientifique".
Aujourd’hui, dans l’optique d’une gestion
durable des forêts, on tente d’établir des
passerelles entre connaissances scienti-
fiques et savoir-faire autochtones en
matière d’espèces forestières. Néanmoins,
ces tentatives viennent tout juste compléter
des protocoles gouvernementaux "officiels"
et se limitent souvent à apposer le label de
connaissances scientifiques aux savoirs
locaux et autochtones, privant par là même
les populations locales de tout pouvoir.
Cartographie par satellite
Qui protège les forêts d’Afrique centrale
et occidentale ? Si l’on considère les com-
munautés locales comme étant l’ennemi,
alors le "protecteur"
de jure
est le Ministère
des forêts. Pourtant, de nombreux cas exis-
tent au niveau local où les règlements issus
des traditions et coutumes locales servent à
protéger les forêts des utilisateurs "exté-
rieurs" et de la surexploitation. Dans de tels
cas, les communautés locales sont les pro-
tecteurs
de facto
des forêts, car les États
n’ont pas la logistique nécessaire pour assu-
rer une présence effective comparable à
celle dont jouissent
ces communautés. Dans
des pays plus progressistes, certains
de ces règlements ont été intégrés et liés à
des "lois formelles" pour renforcer, non pas
la protection des forêts
per se
, mais plutôt la
gestion communautaire des forêts, en asso-
ciant acteurs publics et locaux.
Les satellites ont été et restent une
source essentielle d’information pour aider
à la gestion des forêts. Leur réelle utilité
pour les gérer et les protéger semble
cependant surestimée. Les satellites
peuvent aider à améliorer la précision de la
cartographie des forêts, la détection et la
quantification de leur dynamique, par
exemple leur recul et leur dégradation.
Non seulement du fait de leur évidente pré-
cision, mais aussi parce que, pour un niveau
de précision acceptable, ils sont moins
onéreux que des moyens conventionnels.
On nous annonce la possibilité de surveiller
en temps réel la dynamique des forêts
(phénomènes d’incendie, d’empiètement…),
mais il y a encore loin de la théorie à la pra-
tique. Un défi majeur consiste à traduire
les images et les informations satellitaires
en actions concrètes sur le terrain. Sans
cette avancée, les satellites d’observation
conserveront certes un fort potentiel et
nous fourniront de belles images mais,
dans la pratique, leur apport restera limité.
La technologie satellitaire peut jouer
un rôle pour que la réduction des émis-
sions issues de la déforestation et de la
dégradation des forêts (REDD) devienne
une réalité. Toutefois, l’un des problèmes
actuels de ce mécanisme est de définir un
consensus sur les niveaux de précision
minimum scientifiquement acceptables en
matière d'estimations de déforestation, de
détection de la dégradation et d’émissions
de dioxyde de carbone. Ce manque de
clarté dans le consensus scientifique est
aggravé par le déficit de leadership des
institutions nationales, le manque de
capacité pour recevoir régulièrement des
données satellitaires de qualité et d’en
tirer des informations valables et accep-
tables. Trop d’inconnues subsistent. Nous
disposons néanmoins d’une très grande
marge de manœuvre pour des négociations
sur la disponibilité des images satellitaires,
sur la portée des décisions et les niveaux
acceptables de précision, sur le contrôle
qualité, la logistique et enfin les ressources
humaines pour traiter ces images.
c
Peter Mbile
Spécialiste de la gestion des ressources
naturelles intégrées
Cameroun
La Global Forest
Observations
Initiative (GFOI)
de GEO aidera les
pays à mettre en
place le National
Forest Monitoring
Systems (NFMS), un
système efficace en
termes de coût, durable,
à la fois conforme aux
directives internationales
et respectuex de la
souveraineté nationale.
La disponibilité continue
des données satellitaires,
les conseils méthodologiques
et les capacités associées
incluent les services de soutien
clés des principaux pays en
cours d'élaboration.
Ici, une technicienne localise un
arbre remarquable grâce à son
GPS.
© Peter Mbile
Biodiversité - 77