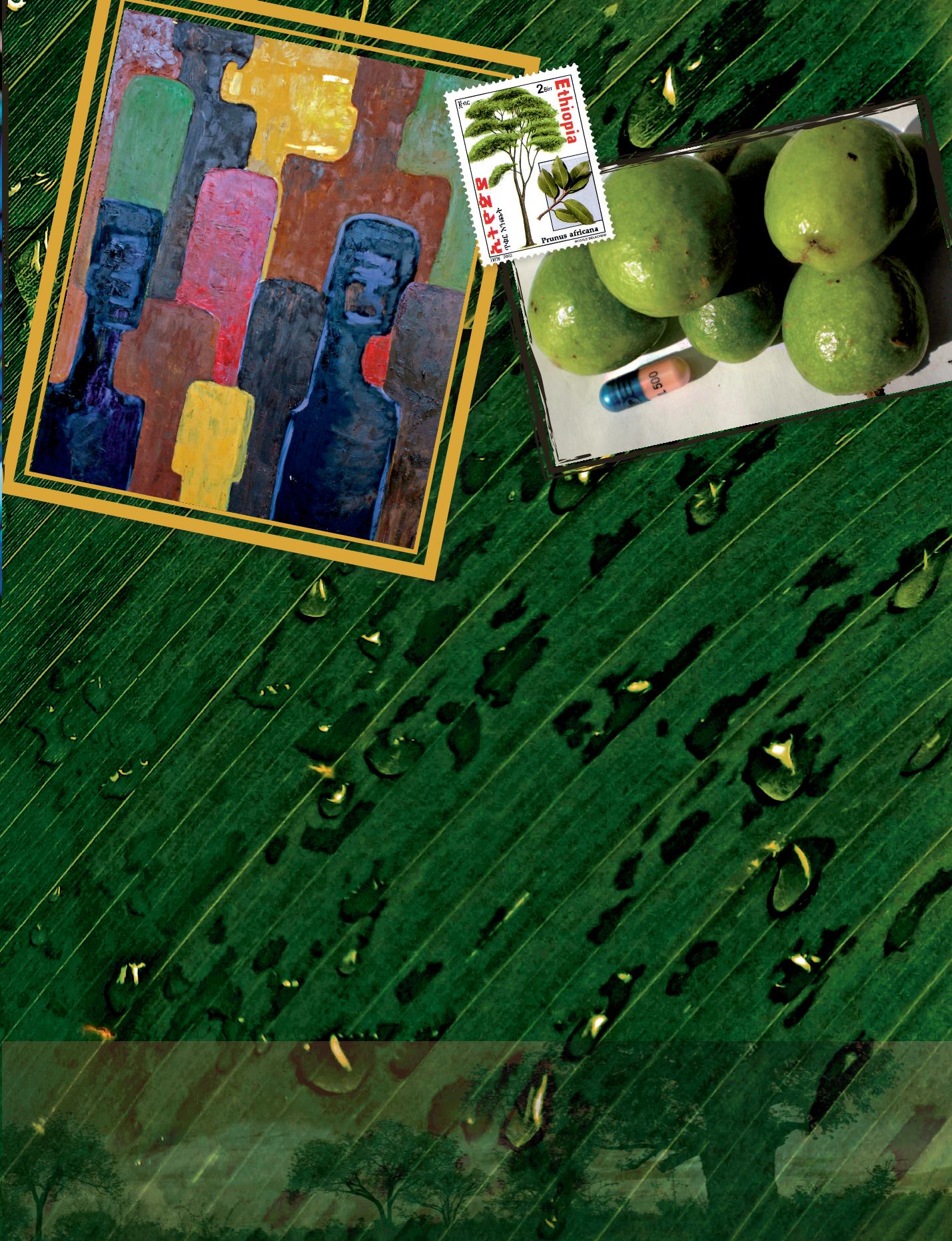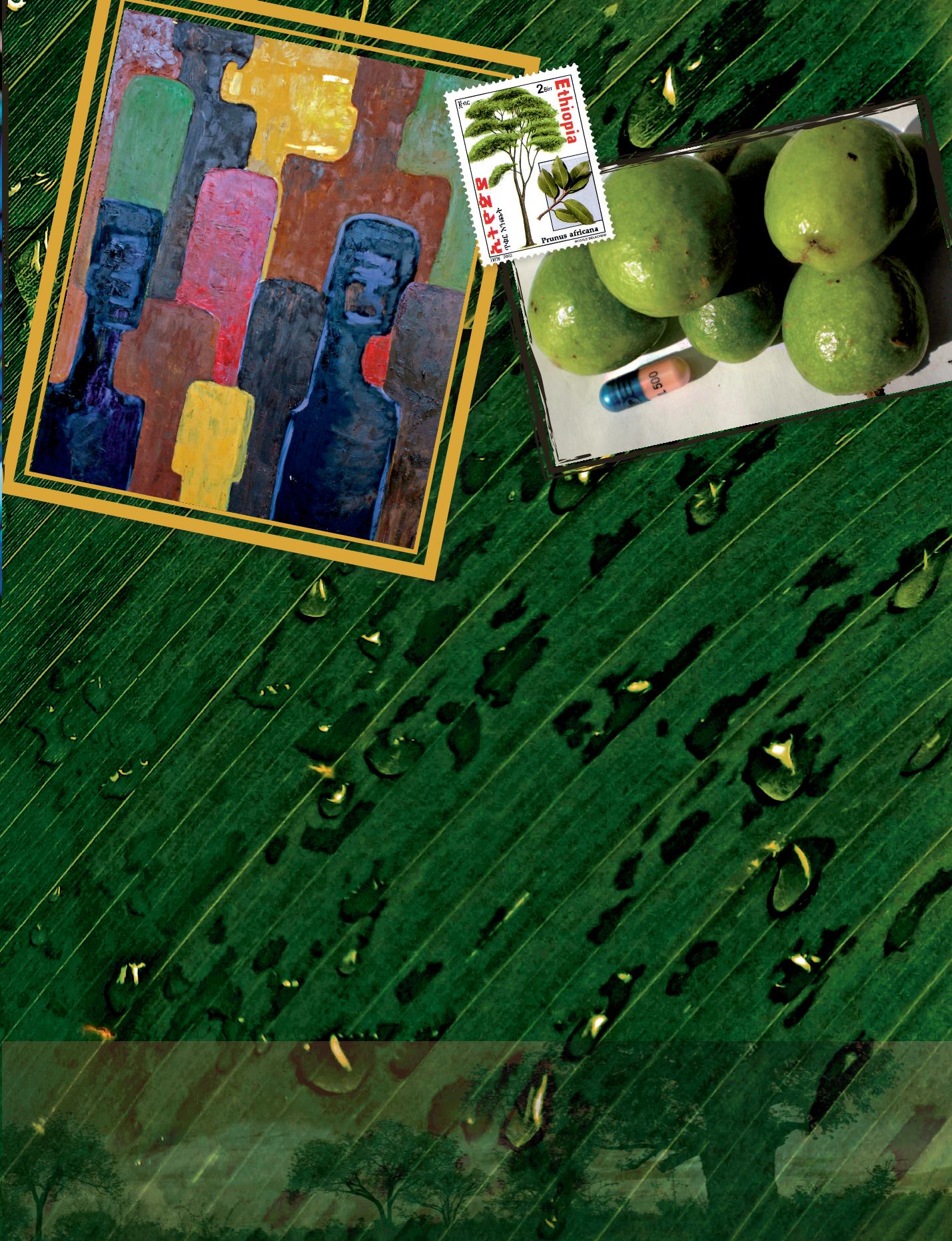
Autre domaine d’inquiétude, l’eau. De-
puis les années 80 la qualité de celle des
fleuves et des rivières s’est dégradée en
Afrique alors qu’elle s’est améliorée en Eu-
rope, en Amérique du Nord, en Amérique
latine et dans les Caraïbes.
Quant au développement prometteur
des biotechnologies, il doit s’accompagner
d’une gestion appropriée des ressources.
Faute de quoi on peut craindre leur dispari-
tion et la montée de nouveaux conflits
portant sur les règles de partage et d’ap-
propriation de ladite richesse.
Pourquoi protéger la biodiversité ?
O
utre les raisons économiques et
culturelles évoquées, l’avenir de l’huma-
nité en dépend : l’Évaluation des écosys-
tèmes pour le Millénaire a permis l’ana-
lyse de l’état de 24 fonctions assurées par
les écosystèmes et qui contribuent direc-
tement à notre bien-être.
Or elle conclut que 15 sont en déclin.
Parmi elles, celles qui concernent la four-
niture d’eau douce, la production halieu-
tique marine, le nombre et la qualité des
sites présentant une valeur spirituelle et
religieuse, la capacité de l’atmosphère à
éliminer des polluants, la prévention
contre les risques naturels, la pollinisa-
tion et la capacité des écosystèmes agri-
coles à lutter contre les ravageurs.
Les gestionnaires des zones protégées
mettent souvent en avant les indicateurs de
l’UICN (Union internationale pour la conserva-
tion de la nature) car ils constituent une forte
incitation – financière et politique – de la part
des programmes de conservation nationaux
et internationaux à suivre et à "produire" des
populations d’espèces en danger. La création
des zones protégées permet de lutter contre la
régression continue des écosystèmes et
l’appauvrissement de la diversité biologique.
Les programmes et organismes engagés
en Afrique sont représentés par de nombreux
acteurs (financiers, institutionnels, tech-
niques, politiques, etc.) incluant la société
civile. Les programmes centrés sur la
diversité biologique sont mis en place en
fonction de l’évolution des concepts et des
phénomènes observés et aussi des ten-
dances. Actuellement, l'UICN et d'autres
organismes s’attachent à faire comprendre
le concept de "gouvernance" appliqué à la
gestion de la diversité biologique.
Des objectifs et des outils
Quand on aborde l’aspect des "outils"
en biodiversité, il faut se poser cette question :
pouvons-nous réunir les bases théoriques,
l’efficacité pratique, la capacité à innover et
la volonté politique pour aller de l’avant et
atteindre les objectifs fixés pour réduire la
perte de biodiversité ?
Pour les femmes et les hommes engagés
dans la protection de la biodiversité voici
quelques objectifs :
•
Susciter la volonté politique néces-
saire pour enrayer la dégradation des
écosystèmes, en démontrant clairement
aux décideurs, et à la société en général,
l’importance de la contribution des écosys-
tèmes aux économies nationales ;
•
Commercialiser des services fournis par
les écosystèmes. Cela peut être perçu comme
une avancée considérable quand il existe un
engagement pour la protection de l’environne-
ment. Cette initiative encouragera les parties
concernées à prendre en compte desmesures
justifiées sur le plan économique pour mieux
protéger la diversité biologique ;
•
Veiller au partage juste et équitable
des avantages résultant de l’utilisation des
ressources génétiques (l’un des trois objec-
tifs de la Convention sur la diversité biolo-
gique). Ces avantages pourraient inciter
à préserver la diversité biologique et à l’ex-
ploiter d’une manière durable ;
•
Aider à mobiliser les ressources finan-
cières et techniques nécessaires pour une
meilleure mise en œuvre des différentes
recommandations de la Convention.
c
Florence Palla
RAPAC (Réseau des Aires Protégées d’Afrique)
Libreville, Gabon
La fin des masques.
"En coupant les arbres, asséchant les
cours d’eau, nous n’aurons plus de
cultures. Les masques, représentant
souvent les ancêtres porteurs des bonnes
pratiques, tirent l’alarme ". Youssouf Cissé
(Bamako, Mali), dénonce la menace pesant
sur la biodiversité.
© Youssouf Cissé
Les ingrédients actifs
du
Prunus africana
sont utilisés
pour traiter l’hyperplasie
et l'hypertrophie de
la glande prostatique.
© Droits réservés
Biodiversité - 69